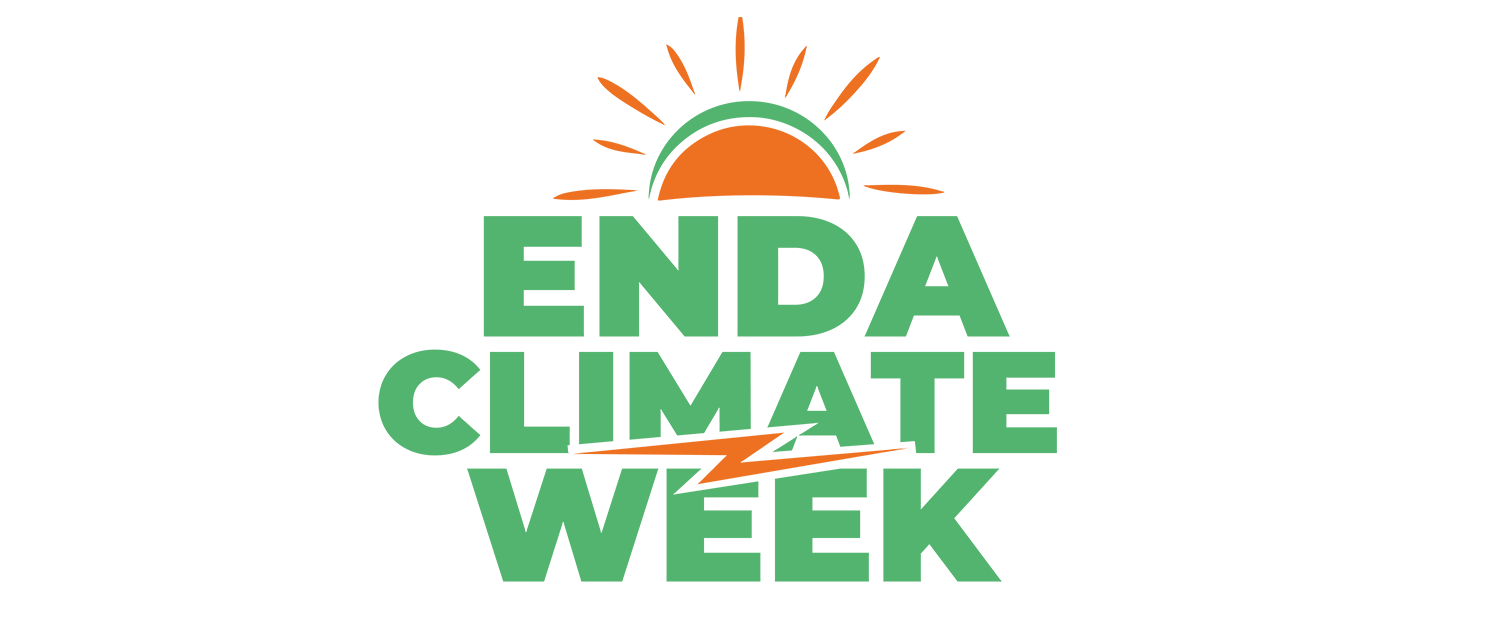Troisième journée de la Semaine Climat & Énergie 2025 : L’adaptation menée localement, du principe à l’action

Au cœur de la troisième journée de la Semaine Climat & Énergie 2025, organisée par ENDA Énergie et ses partenaires, l’attention est portée sur l’adaptation menée localement (LLA – Locally Led Adaptation) et son articulation avec le lancement de l’initiative LIFE-AR. Dans un contexte où le Sénégal, comme d’autres pays les moins avancés (PMA), fait face à une vulnérabilité climatique aiguë malgré une faible responsabilité historique, cette journée a exploré comment transformer les principes de l’adaptation locale en leviers concrets de résilience, de gouvernance et de financement.
La session a été marquée par le lancement national de l’initiative LIFE-AR (Least DevelopedCountries Initiative for Effective Adaptation and Resilience), pilotée par le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique (METE). Présentée par Mme Diallo (METE), cette initiative vise à renforcer la résilience climatique des communautés vulnérables à travers une gouvernance inclusive, l’accès direct aux financements climatiques et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Elle s’inscrit dans la stratégie 2020-2030 du Groupe des PMA et repose sur un pacte de partenariat entre dix pays, dont le Sénégal, et onze partenaires de développement.
En complément, M. Issa Sarr (ENDA Énergie) a présenté le projet GA-LLA (GeneratingAmbition for Locally Led Adaptation), financé par les Pays-Bas et coordonné par l’IIED. Prévu sur 2024-2028, ce projet place les communautés au centre de l’action climatique, à travers quatre volets : soutien direct à 20 initiatives locales, formation de 315 jeunes et femmes, production de connaissances et plaidoyer, ainsi que l’élaboration d’un guide pratique sur l’adaptation menée localement. L’objectif est de transférer le pouvoir de décision vers le niveau local, tout en assurant un ancrage institutionnel et un financement décentralisé.
Les échanges ont souligné la forte convergence entre LIFE-AR et LLA qui reposent toutes lesdeux sur l’implication active des communautés, la décentralisation des ressources et une gouvernance ascendante. Toutefois, leur efficacité dépend de deux conditions clés que sont l’appropriation locale des concepts et leur institutionnalisation au niveau national.
D’une part, les participants ont insisté sur la nécessité de traduire et adapter les principes globaux du LLA en outils accessibles, visuels et en langues locales, afin qu’ils ne restent pas de simples slogans. Il ne suffit pas d’adopter des concepts internationaux ; il faut les “domestiquer” pour qu’ils soient compréhensibles, utilisables et réellement portés par les populations.
D’autre part, il a été recommandé de mettre en place un cadre national de coordination – plateforme ou consortium – porté conjointement par le METE et le ministère des Collectivités territoriales, afin d’aligner les initiatives locales d’adaptation avec les politiques nationales telles que la CDN ou le PNA. Ce cadre permettrait également de clarifier les rôles institutionnels, de mutualiser les expériences et de faciliter la mise à l’échelle des bonnes pratiques.
Plusieurs participants ont interrogé la manière d’intégrer les connaissances endogènes et autochtones dans les politiques climatiques. Les réflexions ont mis en avant la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle liés à ces savoirs, d’accompagner les communautés dans leur valorisation, et de créer à terme une base de données nationale dédiée, soutenue par les partenaires techniques.
La question des financements décentralisés a également été centrale. Malgré les engagements internationaux, près de 80 % des financements climatiques orientés vers l’Afrique n’atteignent pas les organisations locales, ou le font par des canaux complexes et peu adaptés. Les échanges ont plaidé pour la création de mécanismes endogènes de financement, incluant des micro-grants, des plateformes locales de gestion des fonds et une meilleure redevabilité au niveau communautaire.
Un autre point soulevé concerne la faible représentation des jeunes et des pays francophones dans les plateformes internationales comme le CBA (Community BasedAdaptation). La tenue d’une rencontre spécifique pour les pays francophones a été proposée, afin de renforcer leur visibilité et d’enrichir les discussions par une approche transversale.
Les constats majeurs de cette journée révèlent que les concepts globaux d’adaptation sont souvent mal compris ou mal adaptés aux réalités locales. Pourtant, de nombreuses communautés sénégalaises appliquent déjà, sans les nommer, certains principes de l’adaptation menée localement. L’enjeu est désormais de documenter ces pratiques, de capitaliser les leçons et de les intégrer dans les politiques nationales.
Parmi les perspectives clés, les participants ont appelé à une harmonisation des approches locales et nationales, à une institutionnalisation durable des cadres de coordination, et à une traduction pratique des concepts en actions concrètes. Les propositions incluent la mise en place d’une gouvernance multi-acteurs, l’encouragement de l’apprentissage par l’action (“learning by doing”), et le renforcement des capacités locales sur la gestion des risques climatiques.
Cette troisième journée a démontré que l’adaptation menée localement n’est pas seulement une approche conceptuelle, mais une réalité à ancrer institutionnellement et financièrement. Le Sénégal ouvre donc la voie à une résilience inclusive, où les communautés deviennent de véritables architectes des solutions climatiques, pour construire une adaptation enracinée dans les territoires, portée par les savoirs endogènes, soutenue par des financements décentralisés et alignée avec les politiques nationales.