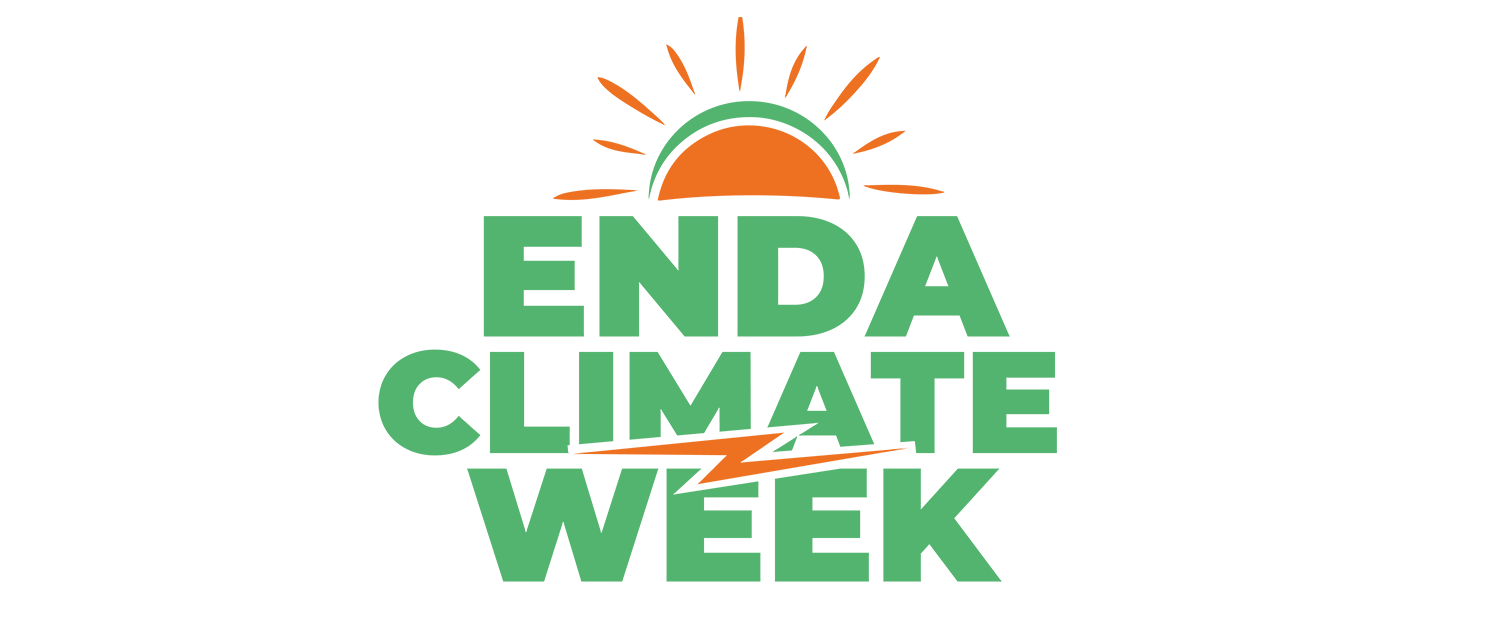Quatrième journée de la Semaine Climat & Énergie 2025 : Pour une transition énergétique juste et durable, construite avec tous les acteurs

La quatrième journée de la Semaine Climat & Énergie 2025 a mis en avant la question de comment bâtir une transition énergétique qui soit à la fois rapide, inclusive et équitable ? Alors que le continent africain regorge de ressources naturelles stratégiques, il demeure confronté à une pauvreté énergétique criante. En effet, plus de 570 millions de personnes restent privées d’électricité et près d’un milliard utilisent encore des moyens de cuisson traditionnels, avec des impacts sanitaires et environnementaux majeurs. À cela s’ajoute un paradoxe profond : l’Afrique ne capte que moins de 2 % des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. C’est dans ce contexte que la parole a été donnée aux acteurs non étatiques (ANE) – syndicats, société civile, secteur privé et communautés de base – afin de décliner leurs besoins, perceptions et attentes face à une transition énergétique qui se veut non seulement durable, mais véritablement juste.
Les débats ont réuni des intervenants représentant syndicats, société civile, secteur privé et communautés de base. Samba Fall, d’ENDA ENERGIE, a rappelé que la transition énergétique doit, avant tout chose, être une opportunité économique pour le continent. Selon lui, les énergies propres offrent la possibilité de bâtir de nouveaux modèles de croissance mais ces perspectives restent peu accessibles aux entreprises locales, faute d’un cadre favorable. Il a insisté sur la nécessité d’adapter les stratégies de transition au contexte national, tout en misant sur la formation des jeunes pour les préparer aux métiers d’avenir. De son côté, AstouDiop, de CAJUST, a souligné que la justice et la durabilité ne sont pas encore garanties dans les pratiques actuelles. Elle a pris l’exemple de Saint-Louis, où l’exploitation du gaz naturel restreint les zones de pêche et compromet les activités agricoles, impactant directement les familles et les femmes transformatrices de poisson. Elle a insisté sur la nécessité d’informer et de sensibiliser les communautés, encore trop souvent tenues à l’écart des processus décisionnels, alors même qu’elles subissent les effets les plus directs des transitions.
La perspective syndicale a été portée par Babacar Sylla de la CNTS, qui a replacé la protection sociale au cœur de la discussion. Pour lui, la formalisation des contrats de travail et la création d’emplois décents sont des conditions indispensables pour que la transition énergétique bénéficie aux travailleurs et renforce la cohésion sociale. Cette approche a été complétée par Babacar Diouf de LSD, qui a mis en évidence l’importance de la transparence et de la participation communautaire. Ainsi a-t-il relevé des cas où des terres destinées aux populations affectées par les effets du changement climatique ont été réaffectées sans concertation, créant frustration et incompréhension. Enfin, selon Moustapha Diagne du SYNTICS de souligner qu’atteindre 40 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique ne signifie pas abandonner brutalement les installations thermiques. Il s’agit plutôt de progresser par étape, afin de préserver la capacité de production industrielle du pays tout en intégrant progressivement les énergies propres.
Les échanges avec l’assistance ont prolongé et enrichi ces interventions. Plusieurs questions récurrentes ont émergé, confirmant la nécessité d’un accompagnement solide. La formation d’une ressource humaine qualifiée est apparue comme une priorité, tant pour répondre aux exigences techniques de la transition que pour offrir des opportunités économiques aux jeunes. L’accès à l’information a également été jugé essentiel, afin que les différents acteurs puissent planifier à long terme et anticiper les mutations. Les discussions ont mis en avant la gestion des minerais critiques, indispensables aux technologies de transition comme le solaire photovoltaïque, et sur lesquels les données disponibles restent encore trop limitées. L’efficacité des études d’impact environnemental a aussi été interrogée, certains participants estimant qu’elles ne suffisent pas à garantir une véritable sauvegarde environnementale. Ainsi, si la participation des communautés est jugée indispensable, il reste à définir les mécanismes concrets qui leur permettraient d’être pleinement actrices de la transition.
Au terme des échanges, plusieurs constats majeurs se sont imposés. D’abord, les procédés actuels de transition énergétique sont jugés peu adaptés aux réalités africaines ; ce qui limite leur efficacité et leur appropriation. Ensuite, les communautés, bien que souvent marginalisées, doivent être considérées comme une partie de la solution et non comme de simples bénéficiaires. Enfin, il est apparu que le JETP reste trop enfermé dans les débats institutionnels, alors même que les populations concernées peinent à y trouver leur place. Ces constats ouvrent des perspectives critiques pour la planification des prochaines étapes, notamment en matière d’accès aux financements, de responsabilité sociale des entreprises et de gestion durable des minéraux critiques.
Les recommandations formulées à l’issue de la journée vont toutes dans le sens d’un renforcement du dialogue et d’une meilleure intégration des parties prenantes. La mise en place de plateformes d’intercommunalité voire d’inter-territorialité est apparue comme une piste prometteuse pour mutualiser les ressources et attirer les investisseurs. Le Haut Conseil du Dialogue Social a été appelé à jouer un rôle accru dans l’inclusion et la protection des communautés. Les principes de l’adaptation locale (LLA) ont été évoqués comme une base pour ancrer la transition écologique dans les réalités territoriales. Les participants ont aussi insisté sur la nécessité d’exiger des entreprises davantage de transparence, notamment à travers des plans de gestion environnementale et sociale. Enfin, l’importance d’une collaboration interministérielle et d’une réflexion africaine sur l’industrialisation adaptée au JETP a été largement partagée.
En définitive, cette quatrième journée a mis en évidence le fait que la transition énergétique ne peut être réussie qu’à condition d’être conçue comme un processus inclusif, transparent et adapté aux réalités locales. Elle ne doit pas être imposée de l’extérieur ou restreinte aux cercles institutionnels, mais co-construite avec l’ensemble des acteurs, de l’État aux communautés de base, en passant par les syndicats et le secteur privé. Seule une telle approche permettra de garantir que la transition énergétique soit véritablement juste et durable, et qu’elle devienne un levier de développement économique, social et environnemental pour le Sénégal et pour l’Afrique.